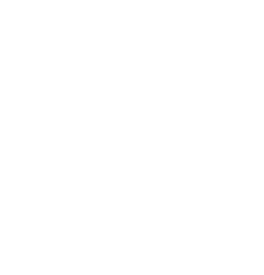EXTRAIT DU LIVRE : LE MOUVEMENT COMMUNAL ET MUNICIPAL AU MOYEN ÂGE

Nous avons parcouru, du Nord au Midi, la France de nos pères, en suivant le mouvement communal ; nous avons pénétré dans les cités et sur les places publiques, et partout nous avons rencontré un peuple entier, délibérant sur ses propres affaires, dans un forum que Rome et Athènes n’avaient point connu. Ainsi nous avons pu mesurer le pas immense que l’Église a fait faire à l’humanité. Il y a quelques siècles à peine, ces hommes étaient esclaves : le christianisme paraît, et les rend libres, au point qu’il est désormais impossible de reconnaître dans ces fiers citoyens du moyen âge les esclaves de l’antiquité. Mais ici, une question de la plus grande importance se présente naturellement : Comment leurs principes, en apparence contraires, celui de l’hérédité monarchique et celui de la démocratie communale purent-ils se développer simultanément et, loin de se combattre, se prêter un mutuel appui ?
C’est ce qu’il importe de dégager. ll est une loi, aujourd’hui méconnue, qui domine et éclaire singulièrement l’histoire de tous les peuples, et que l’on peut formuler en ces termes : La liberté est d’autant plus grande que le pouvoir est plus fort et plus respecté.
De Bonald, par la seule puissance du raisonnement et en dehors des faits établis par l’histoire, en avait trouvé la théorie dans une phrase que les peuples doivent retenir : « Quand la monarchie pure, dit le philosophe chrétien, est dans la constitution, la démocratie pure peut et doit être dans l’administration. Si, au contraire, il y a de la démocratie dans la constitution, il faut placer la monarchie dans l’administration ; car il y aurait trop de démocratie, si elle était à la fois dans l’une et dans l’autre.
Après M. de Bonald, un autre philosophe catholique a exposé la même idée avec une égale puissance : « Le pouvoir qui gouverne la société, dit Balmes, doit être fort : s’il est faible, il tyrannise ou conspire ; il tyrannise pour se faire obéir, il conspire pour acquérir la force. ›› Maintenant que nous avons dégagé la loi, appliquons-la à l’histoire.
Il y a dans toute société deux forces contraires, l’une qui tend au centre, l’autre à la circonférence ; la force centripète et la force centrifuge, la première s’appelle la monarchie, la seconde la démocratie. Si la force centrifuge, c’est-à-dire la démocratie l’emporte, le lien social se relâche et la société se dissout dans l’anarchie ; si au contraire la force centiprète, c’est-à-dire la monarchie domine, le lien social devient une chaîne et le césarisme reste la loi de la société. C’est pour n’avoir pas pu trouver la formule dans laquelle doivent se combiner ces deux forces, que l’antiquité païenne, et la révolution qui en est l’image, sont allés alternativement, et sans transition, de la monarchie absolue à la démocratie absolue, du césarisme à l’anarchie. Le moyen âge au contraire, sous l’influence des idées chrétiennes, trouva la formule sociale et, pour ainsi dire, la quantité de monarchie et de démocratie nécessaire dans une société bien ordonnée, pour assurer à la fois l’exercice du pouvoir et des libertés publiques. C’est ainsi qu’à cette époque où l’autorité est respectée, la liberté est garantie, car elle ne se présente plus comme un danger pour le pouvoir, mais comme le complément nécessaire d’un gouvernement fort, dans lequel l’administration, pour emprunter la formule de De Bonald, devient naturellement d’autant plus démocratique que la constitution est plus monarchique.

Alors les communes surgissent de toutes parts, chaque ville écrit sa charte de franchises, chacune a un forum où des citoyens libres dictent eux-mêmes leurs lois, sans que l’État en soit ébranlé ; et grâce à l’autorité royale qui maintient au centre l’ordre et l’unité, la liberté peut rayonner à la circonférence, et la démocratie couler à pleins bords dans le lit de la monarchie. La Révolution devait renverser tout cet ensemble, et pour le vain plaisir de mettre la démocratie dans la constitution, introduire nécessairement la monarchie, c’est-à-dire la centralisation, dans l’administration ; car « il y aurait eu trop de démocratie, si elle avait été partout à la fois. ›› Ainsi tandis que la France antique avait connu tous les avantages de la démocratie, sans en ressentir les inconvénients, il nous était réservé d’en avoir tous les inconvénients sans en connaître les avantages. Quelle étude que celle qui montrerait l’amour que le vieux peuple de France portait à cette royauté nationale, qui était véritablement son œuvre, et la confiance que celle-ci témoignait en retour aux gens des bonnes villes, aux hommes du tiers-état ! L’on verrait combien étaient alors rapprochées par la religion ces deux puissances, aujourd’hui si divisées, le pouvoir et le peuple.
« Il est de la dignité d’un roi, dit Philippe-Auguste, de conserver avec zèle dans leur intégralité et dans leur pureté les libertés, les droits et les anciennes coutumes des villes. ›› Jamais, avant le christianisme, le pouvoir ne s’était présenté aux peuples, avec une pareille mission. Cher fils, dit saint Louis dans ses dernières recommandations, s’il advient que tu viennes à régner, pourvois que tu sois juste ; et si quelque querelle, mue entre riche et pauvre, vient devant toi, soutiens plus le pauvre que le riche, et quand tu entendras la vérité, fais leur droit. Surtout, disait encore le saint roi, garde les bonnes villes et les coutumes de ton royaume, dans l’état et la franchise où tes devanciers les ont gardées, et tiens-les en faveur et amour. Mais comment peindre les rapports qui existaient dans cette société naïve, entre le souverain et ses sujets ? Personne n’est exclu de la présence du roi, dit un ambassadeur vénitien, les valets et les gens de la plus basse condition osent pénétrer dans son cabinet secret. Pendant le dîner du roi, presque tout le monde peut s’approcher de lui et lui parler, comme ferait un simple particulier : de là, une grande familiarité entre le monarque et ses sujets, qu’il traite tous en compagnons. Aussi les bourgeois sont-ils plus royalistes que les nobles, le roi le sait bien ; il va dîner souper chez eux, y faire le compère, et signe même sur le registre de la grande confrérie des bourgeois.››
Les gens du peuple entraient, pour la plus grande part, dans les conseils du roi ; et avant de partir pour la croisade, Philippe-Auguste ordonna d’établir dans chaque prévôté quatre prud’hommes, sans l’avis desquels les officiers royaux ne pourraient prendre aucune décision. À Paris, il confie même la garde des sceaux de l’État à six bourgeois de la ville, ayant plus de confiance en eux que dans la noblesse. L’ordonnance des monnaies, sous saint Louis, est signée par des roturiers des principales villes ; de même, celles de 1303 et 1309 ; en 1314, des bourgeois de quarante et une villes sont réunis dans le même but : leur avis nous a été conservé. C’est aux roturiers et aux gens de métiers que Louis XI confia la garde de Paris. Par une ordonnance de 1467, datée de Chartres, signée par le roi et contre-signée par l’évêque d’Évreux son conseiller, il est dit que « le roi a l’intention d’armer, pour la sûreté et protection de sa bonne ville de Paris, les gens de tout état qui s’y trouvent. ›› Sur ce, ses commissaires, d’accord avec les habitants, décident, par le premier article, que tous les gens de métiers et marchands de la ville de Paris seront répartis en soixante et une compagnies ou bannières, accompagnées « de telles enseignes et armoiries que lesdits mestiers et compagnies adviseront. ››
L’art. 3 met à la tête de chaque compagnie un principal et un sous-principal, élus par les chefs d’hôtel de chaque métier, et qui devront prêter serment au roi sur les saints Évangiles. Au moyen âge, d’ailleurs, le peuple était une puissance, dont les communes et les corporations de métiers étaient la plus solide garantie. M. Louis Blanc, dont les sympathies ne sont pas suspectes, nous trace le tableau suivant des corporations d’ouvriers au moyen âge : « La fraternité, dit-il, fut l’origine des communautés de marchands et d’artisans. « Une passion, qui n’est plus aujourd’hui dans les moeurs et dans les choses publiques, rapprochait alors les conditions et les hommes : c’est la charité. L’église était le centre de tout ; et quand la cloche de Notre-Dame sonnait l’Angelus, les métiers cessaient de battre. Le législateur chrétien avait défendu aux taverniers de jamais hausser le prix du gros vin, commune boisson du menu peuple ; et les marchands n’avaient qu’après tous les autres habitants, la permission d’acheter des vivres sur le marché, afin que le pauvre put avoir sa part à meilleur prix. C’est ainsi que l’esprit de charité avait pénétré au fond de cette société naïve qui voyait saint Louis venir s’asseoir à côté d’Etienne Boileau, quand le prévôt des marchands rendait la justice. ››

Le mouvement communal et municipal au moyen âge
Les Français d’aujourd’hui ont perdu la mémoire des libertés d’autrefois ; les communes du moyen âge ne réveillent aucun souvenir : car ces grandes choses furent l’oeuvre des siècles de foi. Si l’Église n’avait pas couvert de son manteau ces magnifiques institutions leur nom serait dans toutes les bouches.