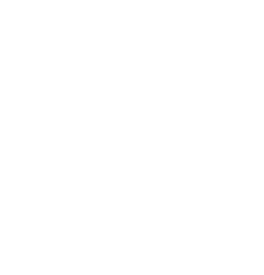Bertrand Duguesclin : la vie du héros médiéval breton
Il est certain qu’avant les croisades les ancêtres de Bertrand ne tenaient point un rang très distingué dans la noblesse de la Bretagne ; diverses expéditions d’outre-mer les illustrèrent en les ruinant. Cette famille supporta sa mauvaise fortune avec dignité. Quelques alliances l’avaient déjà un peu relevée, lorsque Renaud, père de Bertrand, répara les pertes que sa maison avait essuyées, et lui donna un nouveau lustre par son mérite personnel ; il épousa Jeanne de Mallemains, châtelaine d’une beauté rare ; il eut de ce mariage trois garçons et six filles. À la fin de 1320, la dame de Mallemains mit au monde son aîné, le héros dont nous écrivons la vie. Bertrand de Saint-Pern en fut le parrain. La naissance d’un fils dans une famille noble causait beaucoup de joie ; c’était l’héritier du nom et de la gloire de ses aïeux : l’on cherchait à lire d’avance dans ses traits, dans sa conformation, les indices de sa grandeur future. On peut juger du désespoir du père et de la mère de Bertrand, quand ils le virent d’une laideur si repoussante que l’amour maternel lui-même ne pouvait se faire illusion. Le temps, loin de diminuer cette laideur, ne fit que la rendre plus sensible.
La chronique de Mesnard le dépeint de la manière suivante :
« Il étoit laid en façonnet et malgracieux, n’étoit plaisant ni de visage ni de corsage, car il avoit le visage moult-brun et le nez camus, et, avec ce, étoit rude de taille de corps, rude aussi en maintieng et en paroles, et pour ce, son dit père et sa dite mère desiroient sa mort. »
Nous ajouterons à ce portrait que Bertrand avait les yeux vairons et à fleur de tête, le front renversé en arrière, ce qui rendait son nez saillant quoiqu’il fût court ; son cou, très gros, était penché à gauche et donnait à son buste une raideur désagréable ; il avait les bras fort longs et les mains petites et blanches, les épaules très larges ; sa taille était moyenne ; l’ensemble de sa personne, quoique désagréable au premier aspect, annonçait une force extraordinaire.
À peine Bertrand fut-il né qu’il devint l’objet de l’aversion générale dans la maison de son père, dont la famille s’augmenta bientôt de deux autres fils aussi beaux que leur frère était laid ; on éloigna donc l’aîné en l’abandonnant aux soins des domestiques, qui, réglant leurs sentiments sur ceux de leurs maîtres, ne se piquèrent pas de respect pour un enfant qu’on semblait rejeter. Les mauvais traitements irritèrent le jeune Bertrand, son caractère s’aigrit ; il devint, dit la chronique, méchant, rude, malotru et de mauvaise jeunesse ; toujours refrogné, tapi dans un coin, prêt à se ruer sur ceux qui paraissaient le regarder avec mépris, il se vit obligé de se garantir des attaques continuelles des gens de la maison ; mais il ne tarda pas à se sentir capable de repousser les outrages, et bientôt il en vint à punir les domestiques de leur insolence : ceux-ci, se croyant soutenus, lui ripostèrent ; il s’ensuivit une sorte de lutte perpétuelle qui lui faisait passer les jours à battre et à être battu : telles furent les premières années de celui qui, par son courage, devait être un jour le vengeur et le soutien de la France. Tout est précieux dans un homme comme Duguesclin ; les moindres détails ont un intérêt puissant, c’est ce qui nous fera pardonner de nous appesantir un peu sur les premiers temps de sa vie. Il sortit enfin de sa tendre enfance pour entrer dans l’âge où l’on reçoit les premières leçons ; on lui donna un précepteur, mais ce soin fut inutile, au bout de quelques jours, l’élève força le maître à s’enfuir. Cette indocilité attira sur le coupable la juste sévérité de sa mère, qui le bannit de sa table et le fit loger dans une chambre séparée comme un enfant intraitable et qu’il fallait abandonner.
CLIQUEZ ICI POUR COMMANDER LE LIVRE SUR LA VIE DE BERTRAND DUGUESCLIN
Le jeune Bertrand atteignit sa onzième année ; on le crut amendé, et on lui permit un jour de fête (l’Assomption) de reparaître au dîner de famille : il était d’usage, dans les maisons bien réglées, de mettre les enfants à une petite table, touchant presque celle des parents ; on plaçait les fils du châtelain par rang d’âge, de manière à ce que les aînés se trouvassent assis dans le bout le plus rapproché de la grande table. Bertrand vit avec dépit qu’on n’avait pas observé à son égard l’usage établi ; en effet, il se trouvait relégué à l’autre extrémité, tandis que ses frères et ses sœurs se serraient auprès de leur mère, qui les servait les premiers. Il resta quelque temps immobile sur son siège ; mais enfin, ne pouvant plus se contenir, il se leva furieux et vint déclarer à ses frères, qu’étant leur aîné, il avait le droit d’être servi avant eux ; les autres enfants, qui le redoutaient, lui cédèrent la place au plus vite, et Bertrand vint hardiment s’asseoir non loin de sa mère, qui n’avait pu s’empêcher de sourire en le voyant revendiquer aussi énergiquement son droit d’aînesse.
Mais bientôt Bertrand porta la main à tous les plats, et mit le service en une telle confusion, que la châtelaine fut obligée de le renvoyer. Le jeune homme obéit d’abord, mais il revint en courroux peu d’instants après ; il saisit la petite table et la renversa violemment sur ses frères et sœurs. Une pareille conduite allait lui attirer une punition exemplaire ; déjà les gens de la maison avaient voulu se saisir du coupable, qui se débattait vigoureusement entre leurs bras, lorsqu’on annonça une abbesse, parente de la dame de Mallemains. La religieuse, étonnée du désordre qui régnait dans l’appartement, aperçut, dans un coin, Bertrand, encore tout ému de la terrible scène qui venait de se passer, et tenant le bâton dont il était toujours armé. Elle n’eut pas de peine à deviner que ce jeune garçon était la cause de cette agitation ; elle l’attira à elle en le flattant. Duguesclin se laissa amener, traînant derrière lui la gaule dont il ne se dessaisissait jamais ; ses vêtements étaient en désordre : il avait perdu une de ses chaussures en se débattant contre les domestiques. La religieuse le considéra longtemps, et parut frappée de sa tournure vigoureuse et de l’air énergique qui dominait dans toute sa personne. Devinant qu’on l’avait aigri mal à propos, elle essaya de le gagner par des procédés plus bienveillants, mais la dame Duguesclin l’en détourna en pleurant.
« Vos soins sont inutiles, dit-elle, c’est le plus méchant enfant du pays, il fait ma désolation : il s’échappe de la maison, attaque tout le monde ; il est toujours battant ou battu ; son père et moi nous voudrions le voir mort. »
La douleur de cette pauvre mère toucha l’abbesse, qui la consola de son mieux : c’est sans doute dans cette intention qu’elle dit :
« Je veux tirer l’horoscope de mon jeune parent. » (La chiromancie était de mode).
Elle prit la main de Bertrand, que la curiosité rendit attentif ; et après en avoir considéré les linéaments, elle s’écria :
« Je vois que cet enfant deviendra un homme très remarquable, et qu’il fera des choses surprenantes ; il sera l’honneur de sa race et de sa patrie ! — Je n’en crois rien, dit alors le maître-d’hôtel, qui était resté dans la salle avec les autres gens de la maison, car c’est le plus mauvais garnement de la contrée ; certainement il restera tel. »
Ces paroles indiscrètes confirmèrent l’abbesse dans l’idée que toute la maison se plaisait à maltraiter cet enfant.
« Je ne m’en dédis point, répondit-elle, il fera l’orgueil de son pays. »
La religieuse avait jugé qu’il fallait piquer l’amour-propre de ce jeune garçon, et consoler en même temps une mère désolée. La fortune voulut qu’elle ne se trompât point : il n’est pas étonnant que l’opinion populaire ait regardé comme l’effet du merveilleux ce qui n’était qu’un heureux effet du hasard. Quoi qu’il en soit, les paroles de l’abbesse émurent singulièrement Bertrand, et dès ce moment son cœur s’ouvrit à de nouveaux sentiments. Le lendemain on remarqua déjà un changement : on le mit à table avec toute sa famille et la religieuse ; il y conserva une tenue décente ; et lorsque, vers le milieu du repas, on apporta avec les cérémonies d’usage le paon rôti, le jeune Bertrand alla le prendre des mains du maître d’hôtel, et vint avec grâce en faire hommage à l’abbesse qui lui avait prédit un si bel avenir. Il lui promit de se conduire dorénavant de manière à contenter tout le monde ; il versa ensuite du vin dans une coupe, et la présentant à sa parente, il la pria d’en boire pour l’amour de Bertrand. La prédiction de la bonne religieuse ne s’effaça jamais de son souvenir, elle contribua beaucoup à lui inspirer, lors de ses premières armes, une confiance aveugle en sa destinée.